7 juin 2011
Quelques livres sur le bord du chemin, à lire le temps d’une halte…
Posté par Paul dans la catégorie : l'alambic culturel; mes lectures .
Célébrations de la nature – John Muir – traduction André Fayot – Ed. José Corti
 Il me semble incontournable, un de ces quatre, de rédiger une chronique à propos de John Muir, pionnier de l’écologie aux Etats-Unis, ardent promoteur de la création des premiers parcs nationaux et « peintre littéraire » de somptueux portraits de la nature sauvage du grand Ouest américain. Il a tout à fait sa place dans les évocations historiques de ce blog, aux côtés d’un Père David, d’un Alexandre Humboldt ou d’autres explorateurs naturalistes célèbres. J’ai découvert son existence récemment, en lisant les chroniques rédigées par mon explorateur de fils à l’occasion de son périple dans les Rocheuses en 2010. Les éditions José Corti viennent de publier un recueil de textes courts écrits par John Muir pour différentes revues américaines, sous le titre, bien choisi, de « célébrations de la nature ». Le livre commence par un portrait très évocateur de l’auteur, dressé par son ami John Swett et publié en mai 1893 dans le « Century magazine ».
Il me semble incontournable, un de ces quatre, de rédiger une chronique à propos de John Muir, pionnier de l’écologie aux Etats-Unis, ardent promoteur de la création des premiers parcs nationaux et « peintre littéraire » de somptueux portraits de la nature sauvage du grand Ouest américain. Il a tout à fait sa place dans les évocations historiques de ce blog, aux côtés d’un Père David, d’un Alexandre Humboldt ou d’autres explorateurs naturalistes célèbres. J’ai découvert son existence récemment, en lisant les chroniques rédigées par mon explorateur de fils à l’occasion de son périple dans les Rocheuses en 2010. Les éditions José Corti viennent de publier un recueil de textes courts écrits par John Muir pour différentes revues américaines, sous le titre, bien choisi, de « célébrations de la nature ». Le livre commence par un portrait très évocateur de l’auteur, dressé par son ami John Swett et publié en mai 1893 dans le « Century magazine ».
« Pendant plusieurs étés consécutifs et pendant cinq hivers, John Muir a fait de la région de Yosemite son domicile, son quartier général. Il passait l’été et l’automne à explorer les montagnes ; l’hiver à reprendre ses notes, à étudier tempêtes et avalanches ainsi que les mœurs des oiseaux et d’autres animaux. Durant ses plus longues randonnées, quand les dernières miettes de pain étaient épuisées, il redescendait jusqu’au point le plus rapproché de la zone de possible ravitaillement et remplissait son sac, avant de se volatiliser à nouveau dans la nature – souvent en disant qu’il aurait aimé faire un unique repas au printemps mais qui durerait tout l’été, pour qu’il pût mener ses études sans interruption… »
 Les dix-sept textes sélectionnés, tous d’un grand intérêt, sont extraits de trois de ses livres : « Mountains of California », son premier ouvrage, « Our National Parks » et « Steep Trails » (ouvrage posthume). Les deux textes qui m’ont le plus accroché – et ce n’est pas un hasard – ce sont « tempête dans la forêt » et surtout « les séquoias de Californie ». Ce dernier récit détaille les recherches que l’auteur a effectuées concernant la répartition géographique et l’implantation des deux grandes espèces de sequoias (Sempervirens et Gigantea). L’intérêt scientifique de cette étude est indéniable, mais ce qui m’a surtout enthousiasmé, c’est le talent avec lequel Muir dresse le portrait de ces géants exceptionnels, témoins survivants d’une bonne part de l’histoire humaine. C’est dans ses descriptions, généralement plus pittoresques que grandiloquentes, que l’écrivain fait la démonstration de son talent de peintre de la nature sauvage américaine.
Les dix-sept textes sélectionnés, tous d’un grand intérêt, sont extraits de trois de ses livres : « Mountains of California », son premier ouvrage, « Our National Parks » et « Steep Trails » (ouvrage posthume). Les deux textes qui m’ont le plus accroché – et ce n’est pas un hasard – ce sont « tempête dans la forêt » et surtout « les séquoias de Californie ». Ce dernier récit détaille les recherches que l’auteur a effectuées concernant la répartition géographique et l’implantation des deux grandes espèces de sequoias (Sempervirens et Gigantea). L’intérêt scientifique de cette étude est indéniable, mais ce qui m’a surtout enthousiasmé, c’est le talent avec lequel Muir dresse le portrait de ces géants exceptionnels, témoins survivants d’une bonne part de l’histoire humaine. C’est dans ses descriptions, généralement plus pittoresques que grandiloquentes, que l’écrivain fait la démonstration de son talent de peintre de la nature sauvage américaine.
« C’est seulement pendant sa jeunesse que, comme les autres conifères, il montre une aspiration pour le ciel sous l’espèce d’une pointe effilée et qui croît rapidement. Pendant un siècle ou deux, du reste, ou bien jusqu’à ce qu’il ait atteint entre trente et cinquante mètres de hauteur, l’arbre entier a la forme d’un fer de lance, et , contrairement à la rigidité austère de l’adulte, se montre aussi sensible au vent qu’une queue d’écureuil. A mesure qu’il vieillit, il perd progressivement ses branches basses et les plus hautes s’éclaircissent, tant et si bien qu’il en reste relativement peu. Celles-ci, en revanche, atteignent une grande taille et se ramifient pour se terminer en masses arrondies de rameaux largement couverts d’aiguilles, tandis que la cime de l’arbre prend la forme d’un dôme. Ayant alors atteint son plus haut point de force et de beauté, un air sévère et solennel, il rayonne d’une vie intense et passionnée, frémissant jusqu’au bout de la moindre branche, de la moindre racine, serein comme une coupole de granite… »
Je terminerai cette brève présentation en signalant que la traduction d’André Fayot est remarquable, et la typographie choisie par l’éditeur agréable à parcourir. L’illustration de couverture donne une petite idée des paysages grandioses de la Yosemite Valley.
Le pays des petites pluies – Mary Austin – traduction de François Specq – Ed. Le mot et le reste
 Mary Austin, elle aussi, est née aux Etats-Unis, une trentaine d’années après John Muir. Elle prolonge, avec talent, la lignée des écrivains de nature (*) plus ou moins fondée par son illustre prédécesseur. Elle se situe aussi dans la continuité de l’œuvre d’un Henri David Thoreau, même si la dimension philosophique et politique de son œuvre est plus restreinte. Comme son contemporain John C. Van Dyke, Marie Austin crée un genre d’écriture nouveau, centré sur la description du désert, entité vivante, et de ses occupants, hommes, plantes et animaux. Son approche de la nature est globale. Si elle rejette l’anthropocentrisme, elle ne s’intéresse pas moins au mode de vie des Indiens Paiutes qui vivent en communion parfaite avec leur environnement. Comme le fait remarquer son traducteur, par ailleurs auteur de la préface de l’ouvrage,
Mary Austin, elle aussi, est née aux Etats-Unis, une trentaine d’années après John Muir. Elle prolonge, avec talent, la lignée des écrivains de nature (*) plus ou moins fondée par son illustre prédécesseur. Elle se situe aussi dans la continuité de l’œuvre d’un Henri David Thoreau, même si la dimension philosophique et politique de son œuvre est plus restreinte. Comme son contemporain John C. Van Dyke, Marie Austin crée un genre d’écriture nouveau, centré sur la description du désert, entité vivante, et de ses occupants, hommes, plantes et animaux. Son approche de la nature est globale. Si elle rejette l’anthropocentrisme, elle ne s’intéresse pas moins au mode de vie des Indiens Paiutes qui vivent en communion parfaite avec leur environnement. Comme le fait remarquer son traducteur, par ailleurs auteur de la préface de l’ouvrage,
« Le pays des petites pluies est une magnifique célébration de la beauté sauvage du désert du sud-ouest des Etats-Unis. Alors que pour beaucoup il s’agit d’un territoire simplement brûlé par le soleil et dépourvu de vie, cruel et inhospitalier, Mary Austin lui insuffle une vie extraordinaire. La terre, à ses yeux, excède toujours la simple somme de ses particularités physiques et, tout en donnant des informations précises sur sa géologie, son climat, sa faune et sa flore, elle fait bien plus ressentir sa résonance, sa vibration, ce qu’elle appelle « son esprit ». »
 « Le pays des petites pluies » est paru pour la première fois en 1903. Contrairement à l’ouvrage présenté au préalable, il s’agit là d’un recueil de textes, établi par l’auteure elle-même, une sélection d’articles qu’elle a rédigés pour diverses revues littéraires, notamment « the Atlantic Monthly ». Dans ce livre, contrairement à ce qui s’est passé pour « Célébrations de la nature », je n’ai pas véritablement de texte préféré. Ce que j’apprécie le plus, c’est l’ambiance qui se dégage de l’ensemble des écrits. Pour y être parfaitement sensible, peut-être est-il souhaitable de ne pas faire durer la lecture trop longtemps et de prendre la peine de lire plusieurs nouvelles à la suite. C’est ce que j’avais déjà fait lorsque j’ai parcouru « au pays des sables » d’Isabelle Eberhardt (une autre amoureuse du désert dont je vous ai déjà longuement parlé). La poésie qui se dégage du style employé par l’auteure est alors plus facilement perceptible. Ce qui est certain c’est que, comme pour John Muir, ce livre réveille, au fil des pages, un immense désir de voyages, d’explorations. Comment, en effet, ne pas avoir envie de découvrir ce « pays des petites pluies » (nom que donnent les Indiens à cette région, bien plus agréable à l’oreille que le « désert » de nos cartes de géographie) où se côtoient fragilité et rudesse, aridité et floraisons enchanteresses, silence oppressant et gargouillis des sources naissantes… A travers ses multiples descriptions, Mary Austin donne vie à un paysage dont la richesse n’est perceptible que par celui qui sait s’arrêter, attendre et observer. Elle nous dépeint un écosystème dont l’immense beauté n’a d’égale qu’une fragilité sans commune mesure avec les autres endroits sensibles de la planète.
« Le pays des petites pluies » est paru pour la première fois en 1903. Contrairement à l’ouvrage présenté au préalable, il s’agit là d’un recueil de textes, établi par l’auteure elle-même, une sélection d’articles qu’elle a rédigés pour diverses revues littéraires, notamment « the Atlantic Monthly ». Dans ce livre, contrairement à ce qui s’est passé pour « Célébrations de la nature », je n’ai pas véritablement de texte préféré. Ce que j’apprécie le plus, c’est l’ambiance qui se dégage de l’ensemble des écrits. Pour y être parfaitement sensible, peut-être est-il souhaitable de ne pas faire durer la lecture trop longtemps et de prendre la peine de lire plusieurs nouvelles à la suite. C’est ce que j’avais déjà fait lorsque j’ai parcouru « au pays des sables » d’Isabelle Eberhardt (une autre amoureuse du désert dont je vous ai déjà longuement parlé). La poésie qui se dégage du style employé par l’auteure est alors plus facilement perceptible. Ce qui est certain c’est que, comme pour John Muir, ce livre réveille, au fil des pages, un immense désir de voyages, d’explorations. Comment, en effet, ne pas avoir envie de découvrir ce « pays des petites pluies » (nom que donnent les Indiens à cette région, bien plus agréable à l’oreille que le « désert » de nos cartes de géographie) où se côtoient fragilité et rudesse, aridité et floraisons enchanteresses, silence oppressant et gargouillis des sources naissantes… A travers ses multiples descriptions, Mary Austin donne vie à un paysage dont la richesse n’est perceptible que par celui qui sait s’arrêter, attendre et observer. Elle nous dépeint un écosystème dont l’immense beauté n’a d’égale qu’une fragilité sans commune mesure avec les autres endroits sensibles de la planète.
« Au loin dans l’Ouest, l’ouest des mesas et des collines qui ignorent les droits de propriété, le ciel est plus vaste que partout ailleurs dans le monde. Il ne repose pas d’une manière monotone sur le pourtour de la terre, mais commence quelque part dans l’espace où est suspendue la terre, il est plus concave et empli de vents entêtants. Il y a certaines odeurs aussi qui s’emparent de vous, . Il y a l’odeur printanière de l’armoise qui signale que la sève commence à monter d’un sol qui semble ne contenir aucun des sucs de la vie. C’est le genre d’odeur qui vous fait penser au long sillon que tracerait ici la charrue, le genre d’odeur qui marque le début d’un nouveau feuillage, atteint son apogée en même temps que la plante, et laisse une trace âcre là où broutent les troupeaux sauvages. Il y a l’odeur de l’armoise au coucher du soleil, brûlée dans les campoodies et les campements de bergers, qui se répand par les minces volutes de fumée bleutée […] Il y a l’odeur palpable de la poussière amère qui s’élève des plateaux alcalins à la fin de la saison sèche, et l’odeur de pluie au débouché des canyons. » [ Le sentier de la mesa ]
Elisée Reclus ou la passion du monde – Hélène Sarrazin – Editions du Sextant
 Je ne ferai point ici, aujourd’hui, le portrait d’Elisée Reclus. Je l’ai déjà fait, à de multiples reprises dans ces colonnes, avec un talent bien moindre que celui d’Hélène Sarrazin, qui a su donner, à la biographie qu’elle a rédigée du célèbre géographe, beaucoup de vie et d’humanité. Il est indiscutable qu’Elisée Reclus est, comme on le dit, à nouveau à la mode. On s’aperçoit, après une éclipse d’un siècle, que son approche humaniste et pluridisciplinaire de la géographie n’était peut-être pas si « dépassée » que cela et que la richesse des descriptions qu’il donne des paysages du monde, dans sa « géographie universelle » ou dans « l’homme et la terre » constituent une étape importante dans l’évolution de la géographie en tant que discipline des sciences. Cette « redécouverte » scientifique s’accompagne également d’un intérêt approfondi pour ses idées philosophiques et politiques. Cet homme d’une grande intégrité et d’une grande rigueur morale était un propagandiste acharné du communisme libertaire, et ne voyait d’avenir que pour un monde libéré de ses frontières artificielles, ouvert au multiculturalisme et libéré de l’oppression capitaliste. Hélène Sarrazin conte fort bien la vie mouvementée de ce personnage extraordinaire et de ceux qui l’ont accompagné dans sa démarche : sa famille, à laquelle il était très attaché, notamment deux de ses frères, Elie et Onésime, son neveu, Paul, ou ses compagnes successives : Clarisse, Fanny et la dernière, Florence. Sans cesse la mort a frappé à sa porte : Clarisse décédée de maladie, Fanny, morte en couche, plusieurs enfants partis très jeunes… Bonheur et malheur l’ont côtoyé sans cesse tout au long d’une existence bien remplie, jalonnée d’innombrables voyages. Marcheur infatigable, Reclus explore les montagnes, des Alpes jusqu’à la Sierra Nevada de Sainte Marthe, en Amérique centrale. Seule sa relative notoriété lui permet d’échapper à la sanglante répression qui suit la Commune de Paris, mouvement révolutionnaire dans lequel il s’implique largement. Au fil des chapitres, l’auteure dresse également le portrait de plusieurs célébrités de l’époque que notre géographe a fréquentées plus ou moins assidument : Bakounine, Kropotkine (sur les recherches duquel il s’appuie pour rédiger au moins deux volumes de sa « géographie universelle »), Grave ou Nadar… Elle s’intéresse tout au long de son étude à mieux comprendre l’origine des idées et l’évolution de la personnalité de Reclus ; pour ce faire, elle dresse un portrait détaillé de ses parents, du cheminement éducatif suivi par les deux frères, Elie et Elisée… L’ensemble est rédigé dans un style romancé facile à suivre et n’a pas la sécheresse de ton de certaines biographies universitaires…
Je ne ferai point ici, aujourd’hui, le portrait d’Elisée Reclus. Je l’ai déjà fait, à de multiples reprises dans ces colonnes, avec un talent bien moindre que celui d’Hélène Sarrazin, qui a su donner, à la biographie qu’elle a rédigée du célèbre géographe, beaucoup de vie et d’humanité. Il est indiscutable qu’Elisée Reclus est, comme on le dit, à nouveau à la mode. On s’aperçoit, après une éclipse d’un siècle, que son approche humaniste et pluridisciplinaire de la géographie n’était peut-être pas si « dépassée » que cela et que la richesse des descriptions qu’il donne des paysages du monde, dans sa « géographie universelle » ou dans « l’homme et la terre » constituent une étape importante dans l’évolution de la géographie en tant que discipline des sciences. Cette « redécouverte » scientifique s’accompagne également d’un intérêt approfondi pour ses idées philosophiques et politiques. Cet homme d’une grande intégrité et d’une grande rigueur morale était un propagandiste acharné du communisme libertaire, et ne voyait d’avenir que pour un monde libéré de ses frontières artificielles, ouvert au multiculturalisme et libéré de l’oppression capitaliste. Hélène Sarrazin conte fort bien la vie mouvementée de ce personnage extraordinaire et de ceux qui l’ont accompagné dans sa démarche : sa famille, à laquelle il était très attaché, notamment deux de ses frères, Elie et Onésime, son neveu, Paul, ou ses compagnes successives : Clarisse, Fanny et la dernière, Florence. Sans cesse la mort a frappé à sa porte : Clarisse décédée de maladie, Fanny, morte en couche, plusieurs enfants partis très jeunes… Bonheur et malheur l’ont côtoyé sans cesse tout au long d’une existence bien remplie, jalonnée d’innombrables voyages. Marcheur infatigable, Reclus explore les montagnes, des Alpes jusqu’à la Sierra Nevada de Sainte Marthe, en Amérique centrale. Seule sa relative notoriété lui permet d’échapper à la sanglante répression qui suit la Commune de Paris, mouvement révolutionnaire dans lequel il s’implique largement. Au fil des chapitres, l’auteure dresse également le portrait de plusieurs célébrités de l’époque que notre géographe a fréquentées plus ou moins assidument : Bakounine, Kropotkine (sur les recherches duquel il s’appuie pour rédiger au moins deux volumes de sa « géographie universelle »), Grave ou Nadar… Elle s’intéresse tout au long de son étude à mieux comprendre l’origine des idées et l’évolution de la personnalité de Reclus ; pour ce faire, elle dresse un portrait détaillé de ses parents, du cheminement éducatif suivi par les deux frères, Elie et Elisée… L’ensemble est rédigé dans un style romancé facile à suivre et n’a pas la sécheresse de ton de certaines biographies universitaires…
« Quittant Orthez pour rentrer à Paris, Elisée part à pied avec Onésime pour visiter les Landes. […] Naturellement ils sont enthousiasmés. L’embouchure de l’Adour, contemplée du haut d’une dune, obtient d’Elisée une superbe description. Voilà que commence pour le géographe la vie rêvée. Partir à pied, chaussé de gros souliers, abrité sous un gros paletot aux poches bourrées de crayons et de calepins, manger au bord du chemin son pain et son fromage, rêver mais de cette rêverie que le rythme seul de la marche suffit à rendre tonique… Il ne se plaignait ni du froid, ni de la pluie, seulement des puces dans les gîtes d’étape. Ses compagnons de voyage, il les épuise. Il part pour les Alpes avec Elie et le cousin Broca, l’inventeur des localisations cérébrales. Elie se blesse à la main et repart ; Broca, les pieds en compote, reprend le train à la première gare. »
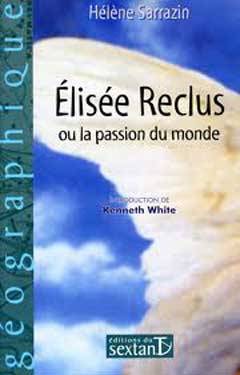 Des ressemblances entre Muir, Thoreau, Reclus ? Sans doute… Un parallèle, sûrement pas. Il n’y a guère de comparaison possible entre le mysticisme d’un John Muir et ses références continuelles à l’œuvre suprême du créateur, et l’indépendance d’esprit de notre géographe voyageur. Elisée parcourt le monde et cherche à le comprendre plus qu’à s’immerger dans une contemplation profonde de la nature. Cela n’empêche, et c’est très visible dans des livres comme « Histoire d’un ruisseau » ou « Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Marthe », qu’il est parfaitement sensible à la beauté et à la poésie des paysages qu’il découvre. Après avoir lu la biographie d’Hélène Sarrazin, on prend plaisir à relire l’introduction de « L’homme et la terre », le volume 1, publié en 1905, deux années seulement après « Le pays des petites pluies » de Mary Austin…
Des ressemblances entre Muir, Thoreau, Reclus ? Sans doute… Un parallèle, sûrement pas. Il n’y a guère de comparaison possible entre le mysticisme d’un John Muir et ses références continuelles à l’œuvre suprême du créateur, et l’indépendance d’esprit de notre géographe voyageur. Elisée parcourt le monde et cherche à le comprendre plus qu’à s’immerger dans une contemplation profonde de la nature. Cela n’empêche, et c’est très visible dans des livres comme « Histoire d’un ruisseau » ou « Voyage à la Sierra Nevada de Sainte Marthe », qu’il est parfaitement sensible à la beauté et à la poésie des paysages qu’il découvre. Après avoir lu la biographie d’Hélène Sarrazin, on prend plaisir à relire l’introduction de « L’homme et la terre », le volume 1, publié en 1905, deux années seulement après « Le pays des petites pluies » de Mary Austin…
« L’émotion que l’on éprouve à contempler tous les paysages de la planète dans leur variété sans fin et dans l’harmonie que leur donne l’action des forces ethniques toujours en mouvement, cette même douceur des choses, on la ressent à voir la procession des hommes sous leurs vêtements de fortune ou d’infortune, mais tous également en état de vibration harmonique avec la Terre qui les porte et les nourrit, le ciel qui les éclaire et les associe aux énergies du cosmos. Et, de même que la surface des contrées nous déroule sans fin des sites de beauté que nous admirons de toute la puissance de l »être, de même le cours de l’histoire nous montre dans la succession des événements des scènes étonnantes de grandeur que l’on s’ennoblit à étudier et à connaître. »
Trois approches du monde qui divergent sans doute dans leur démarche, dans leurs présupposés, mais qui se complètent pour notre plus grand plaisir. Voilà ce que j’ai envie d’écrire pour conclure cette longue chronique voyageuse…
Notes : (*) je préfère le terme « écrivain de nature » à l’anglicisme « nature writer » que les éditeurs français prennent un malin plaisir à utiliser… Nos amis québecois sont nettement plus francophiles et par conséquent attentifs à ce genre de problèmes.
Crédit photo n°2 : Sébastien Chion, « Conception Pourquoi pas »
One Comment so far...
la Mère Castor Says:
9 juin 2011 at 09:54.
Ah, merci, j’apprécie toujours vos conseils de lecture (il m’arrive même de les suivre).